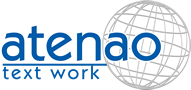Sur la traduction – Paul Ricœur
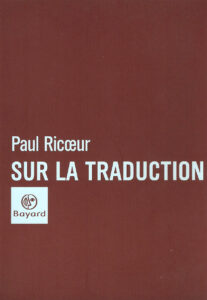
Sur la traduction de Paul Ricœur : penser l’hospitalité des langues et la traduction des documents
Publié en 2004 aux éditions Bayard, Sur la traduction réunit trois conférences de Paul Ricœur, figure majeure de la philosophie contemporaine. En moins de 150 pages, le philosophe réussit à proposer une réflexion dense et lumineuse sur un geste qui traverse l’histoire humaine : traduire. Ni traité technique ni manuel, ce texte est une méditation philosophique, qui dialogue avec la linguistique, l’herméneutique et l’éthique. Ricœur y affirme que traduire, c’est à la fois impossible et nécessaire : impossible, car aucune équivalence parfaite n’existe entre deux langues ; nécessaire, car c’est le seul moyen de circuler entre les cultures, d’accéder aux œuvres et de comprendre l’autre. C’est vrai aussi bien pour la littérature que pour la traduction des documents, où l’exactitude et la fidélité sont mises à l’épreuve à chaque mot.
La tâche du traducteur : entre fidélité et trahison
Dans le premier texte, Ricœur reprend une formule ancienne : traduttore, traditore — « traduire, c’est trahir ». Mais plutôt que d’y voir une condamnation, il en fait une tension constitutive de l’acte traductif.
-
La fidélité absolue est impossible : la langue cible n’a pas les mêmes structures, les mêmes connotations, ni la même histoire que la langue source. Traduire mot à mot conduit souvent à l’absurde ou au contresens.
-
La trahison n’est pas totale : si le texte ne survit qu’en étant transformé, il conserve pourtant une fidélité dynamique, une visée de l’équivalence.
Cette réflexion vaut aussi pour la traduction des documents officiels ou administratifs : il ne s’agit pas seulement de transférer des mots, mais d’interpréter avec rigueur, dans le respect du sens et du cadre juridique.
Ricœur convoque ici Walter Benjamin (La tâche du traducteur), mais aussi Wilhelm von Humboldt, qui voyait chaque langue comme une vision du monde singulière. Traduire devient alors une opération herméneutique : interpréter, comprendre, puis recréer.
Le paradigme de la traduction : un modèle pour penser l’altérité
Le second texte élargit le propos. La traduction n’est pas seulement une opération linguistique : elle devient un paradigme pour penser les rapports entre les hommes, les cultures, et même les disciplines.
Ricœur montre que dans toute communication interculturelle, il existe ce même jeu d’équivalence sans identité. Comprendre l’autre, ce n’est jamais l’absorber totalement, mais accepter de se déplacer vers lui. La traduction est alors une métaphore du dialogue : elle suppose une négociation permanente, une reconnaissance de la différence et un effort de rapprochement.
On retrouve ici l’influence de Gadamer et de son herméneutique dialogique (Vérité et méthode), où comprendre, c’est toujours « se comprendre avec ».
Traduire l’intraduisible : limites et créativité
Dans le troisième texte, Ricœur aborde de front la question de l’intraduisible. Certaines expressions idiomatiques, certaines références culturelles, certaines images poétiques semblent résister au passage. Faut-il alors renoncer ?
Ricœur répond non. Il insiste au contraire sur le fait que l’intraduisible est ce qui oblige le traducteur à inventer. C’est là que réside la créativité traductive : chercher des équivalents fonctionnels, trouver des images qui parlent dans la culture d’arrivée, inventer des solutions qui préservent le souffle du texte original.
L’intraduisible, loin d’être un obstacle, devient un moteur d’invention.
Une éthique de l’hospitalité langagière
C’est sans doute l’apport le plus marquant de l’ouvrage : Ricœur forge la métaphore de l’hospitalité langagière. Traduire, c’est accueillir la langue de l’autre dans la sienne, lui offrir un abri, sans chercher à l’assimiler totalement.
Il s’agit d’une éthique :
-
accueillir sans effacer : la langue étrangère garde son étrangeté, même traduite ;
-
partager sans posséder : la traduction rend le texte accessible, mais il n’appartient pas à celui qui traduit ;
-
accepter la perte : toute traduction implique un renoncement, une part de sens laissée derrière.
Cette métaphore de l’hospitalité inscrit la traduction dans une philosophie du vivre-ensemble : comprendre l’autre sans l’écraser, dialoguer sans prétendre à l’identité parfaite.
Traduction, herméneutique et philosophie de l’histoire
Ricœur rattache aussi la traduction à son œuvre plus vaste, centrée sur l’herméneutique. Traduire, c’est interpréter. C’est accepter que le sens ne soit jamais donné une fois pour toutes, mais toujours médiatisé par les langues, les contextes, les cultures.
La traduction devient une expérience du temps et de l’histoire :
-
Elle transmet les textes du passé au présent, en les reformulant.
-
Elle crée des ponts entre civilisations éloignées.
-
Elle rend possible une mémoire commune et une circulation des savoirs.
Dans cette perspective, traduire, c’est participer à une histoire partagée de l’humanité.
Pourquoi lire Sur la traduction aujourd’hui ?
Cet essai, court mais dense, continue de résonner dans un monde marqué par la mondialisation, les migrations et la confrontation des cultures. Il éclaire :
-
les traducteurs professionnels, qui y trouvent une légitimation philosophique de leur métier ;
-
les étudiants en traduction et linguistique, qui y voient une base de réflexion théorique ;
-
les lecteurs de philosophie, curieux de comprendre comment un acte apparemment technique révèle des enjeux éthiques et politiques profonds.
Paul Ricœur ne livre pas de recettes, mais une leçon d’humilité et de générosité. Traduire, c’est accepter l’imperfection, mais aussi croire que le sens circule malgré tout. C’est pratiquer une hospitalité fragile, mais féconde.
Sur la traduction demeure ainsi un texte fondamental, qui ne s’adresse pas seulement aux traducteurs, mais à tous ceux qui veulent penser la rencontre entre les langues, les cultures et les hommes.
Sur la traduction
Auteur : Paul Ricœur
Date de parution : 8 janvier 2004
Nombre de pages : 120
Langue : Français
Prix : papier 19,99 € – numérique : 12,99 €