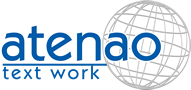Traduction littéraire : le Dictionnaire amoureux de la traduction
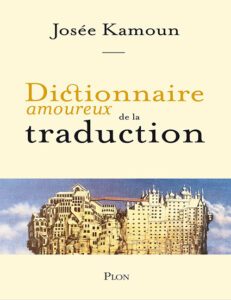
Le Dictionnaire amoureux de la traduction de Josée Kamoun est à la fois un voyage littéraire, un carnet de route professionnel et une déclaration d’amour à un métier qui se déploie dans les interstices des langues. Connue pour ses traductions magistrales d’auteurs tels que Philip Roth, John Irving, William Faulkner ou encore Virginia Woolf, Kamoun, en maître de la traduction littéraire, nous ouvre ici les portes de son univers intellectuel, sensible et passionné.
L’ouvrage adopte la forme caractéristique de la collection « Dictionnaire amoureux » : une série d’entrées classées par ordre alphabétique, chacune dédiée à un mot, une notion, une œuvre ou un auteur liés de près ou de loin à la traduction. Mais chez Kamoun, cette structure devient prétexte à une déambulation, où les anecdotes se mêlent aux réflexions, les portraits d’écrivains aux confessions de traductrice, les analyses précises aux digressions culturelles.
Une vision incarnée de la traduction littéraire
Kamoun ne se contente pas de définir des concepts. Elle les fait vivre à travers son expérience personnelle et sa sensibilité de traducteur professionnel. Traduire, écrit-elle, c’est « habiter deux langues à la fois », se tenir dans un espace mouvant où l’on écoute, compare, ajuste et recrée. Ce n’est ni un simple transfert mécanique de mots, ni un exercice scolaire de correspondance : c’est une pratique où s’entrelacent la rigueur grammaticale, l’intuition poétique et une profonde conscience culturelle.
Elle raconte, par exemple, comment chaque projet s’accompagne d’un rituel : relire le texte original dans son entier, laisser se former une “oreille intérieure” de la voix de l’auteur, puis plonger dans le travail, phrase après phrase, en cherchant le ton juste. Loin d’une simple opération technique, ce processus est pour elle un compagnonnage intime avec l’écrivain.
De Shakespeare à Schéhérazade
Certaines entrées sont de véritables petites histoires littéraires. Dans l’article consacré à Hamlet, Kamoun revient sur les multiples traductions de la pièce, sur les dilemmes posés par des répliques célèbres — « To be or not to be » — et sur la façon dont chaque traducteur imprime sa marque. Dans celui sur Les Mille et Une Nuits, elle explore les versions d’Antoine Galland ou de Richard Burton, révélant comment chaque époque, chaque traducteur, modèle la perception d’un texte.
Ces pages sont nourries d’exemples concrets, parfois de comparaisons mot à mot, qui illustrent la manière dont un choix lexical ou rythmique peut transformer la couleur d’une phrase, voire le sens global d’une œuvre.
Les dilemmes du traducteur
Kamoun consacre plusieurs entrées à des problématiques récurrentes du métier :
-
La question du tu et du vous, et de leur absence d’équivalent direct en anglais.
-
La gestion des connotations et dénotations, où un mot français ne recoupe jamais exactement le champ sémantique de son équivalent anglais.
-
L’importance du rythme et de la musicalité, souvent invisibles pour le lecteur mais fondamentaux pour la cohérence de l’œuvre.
Elle aborde aussi le sujet des notes du traducteur, en expliquant comment elles peuvent éclairer un contexte ou un jeu de mots intraduisible, mais aussi rompre le fil narratif si elles sont trop envahissantes.
Traduire à l’ère de l’intelligence artificielle
L’une des entrées les plus contemporaines est consacrée à l’IA et à la traduction automatique. Kamoun analyse les forces et surtout les limites de ces outils : rapidité et utilité pour des tâches simples, mais incapacité à restituer les nuances culturelles, l’ironie, le ton ou la voix singulière d’un auteur. Elle met en garde contre la tentation de réduire la traduction à un simple traitement de données, et réaffirme que celle-ci reste un acte créatif, ancré dans l’humain.
L’IA, dit-elle, « calcule la probabilité des mots » mais ignore tout du souffle narratif, de la cohérence stylistique et des implications culturelles qui structurent une œuvre. Elle ne comprend pas l’ironie sous-jacente d’une phrase, ne perçoit pas la polyphonie d’un texte où plusieurs voix se superposent, et ne peut saisir la charge émotionnelle d’un mot choisi par l’auteur pour sa rareté ou sa musicalité.
La post-édition, quant à elle, est un exercice que Kamoun compare à une chirurgie délicate : il s’agit de reprendre une traduction brute générée par une machine et de la remodeler pour la rendre fluide, fidèle et vivante. Mais elle met en garde : lorsque le texte de départ est lourdement fautif sur le plan rythmique ou sémantique, la post-édition peut demander autant de temps et d’efforts qu’une traduction intégrale réalisée par un traducteur humain. Le gain de productivité vanté par certains acteurs du marché se révèle alors illusoire, au détriment de la qualité. Kamoun défend une vision où l’IA peut avoir sa place comme outil d’appoint pour certaines étapes du travail (pré-analyse lexicale, repérage de récurrences, aide terminologique), mais elle insiste sur le fait que la véritable valeur ajoutée du traducteur professionnel réside dans sa capacité à interpréter, adapter et réinventer un texte dans une autre langue, en tenant compte des subtilités culturelles et des choix d’écriture.
Un livre pour qui ?
Cet ouvrage s’adresse à plusieurs publics :
-
Aux traducteurs professionnels qui y retrouveront les défis, les joies et les dilemmes du métier.
-
Aux étudiants et apprentis traducteurs, pour qui il constituera un manuel vivant de réflexion et d’inspiration.
-
Aux amoureux de littérature qui souhaitent découvrir l’envers du décor et comprendre comment un texte passe d’une langue à une autre sans perdre son âme.
Une écriture vivante et généreuse
Ce qui frappe à la lecture, c’est la chaleur et l’authenticité de la plume. Kamoun ne cherche pas à “faire école” au sens strict, mais à partager des expériences, des intuitions et des souvenirs. Elle cite des passages d’auteurs qu’elle a traduits, analyse ses propres choix, parfois ses erreurs, et ne craint pas de prendre position. Le tout compose un portrait sincère du métier de traducteur : exigeant, discret, mais essentiel à la circulation des idées et des œuvres.
Dictionnaire amoureux de la traduction
Auteur : Josée Kamoun
Éditeur : Plon
Date de publication : 4 avril 2024
Langue : Français
Nombre de pages de l’édition imprimée : 560 pages
Prix : papier 29,00 € – numérique : 19,99 €